De 2013 à 2015, j’ai été chroniqueuse littéraire à Montréal par la racine (CIBL 101,5). Quelques fois par mois, je présentais des comptes-rendus d’ouvrages portant sur les systèmes alimentaires au Québec et autres sujets connexes. Ce texte a été adapté de ma chronique littéraire du 23 novembre 2015.
La ferme impossible de Dominic Lamontagne
Johanna (animatrice) : Depuis quelques semaines, on entend beaucoup parler d’un nouveau livre qui vient d’être publié aux éditions Écosociété et qui s’intitule La ferme impossible, de Dominic Lamontagne. Mariève a lu l’ouvrage pour nous. Alors, qu’est-ce que cette « ferme impossible »?
Mariève : Pour le décrire très simplement, il s’agit d’une ferme où un agriculteur ou agricultrice pourrait élever deux vaches pour leur lait, 200 poules pour leurs œufs et 500 poulets pour leur viande, à laquelle on ajouterait un potager. Cette ferme serait un peu à l’image des fermes familiales autosuffisantes d’avant la Deuxième Guerre mondiale, qui a constitué pendant plus d’un siècle le modèle d’agriculture au Québec.
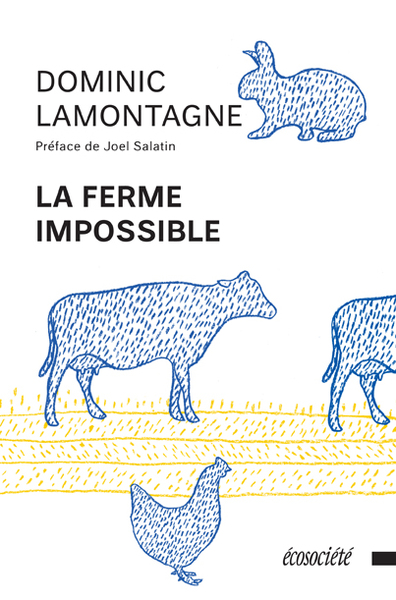
C’est aussi une ferme qui pourrait faire l’abattage sur place, transformer et vendre ses produits, comme par exemple faire du fromage, des pâtés au poulet, de la viande en conserve. Finalement, c’est une ferme qui aurait le droit, si elle le souhaite, de profiter au maximum de l’agrotourisme, notamment en pouvant servir ses propres produits (œufs, lait, etc.) aux visiteurs, ce qui présentement n’est pas vraiment permis.
Johanna : Justement, pourquoi cette ferme est-elle « impossible », comme le titre de l’ouvrage l’indique?
Mariève : En fait, c’est surtout aux quotas, aux lois et à toutes les réglementations qui encadrent présentement l’agriculture au Québec que s’en prend Dominic Lamontagne. Tout le livre est un plaidoyer pour une agriculture plus libre; c’est une charge contre les procédures en place et en particulier contre système de quota et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, qui empêchent, selon lui, un agriculteur ou une agricultrice artisanale d’exploiter une ferme à échelle réduite. Il écrit dans son introduction : « L’objectif premier de mon récit est de documenter et de dénoncer l’étranglement des libertés entrepreneuriales des Québécois dans le domaine de l’agriculture. »

Vous l’aurez peut-être remarqué, il s’agit d’un discours libertarien, un discours qui – et là même l’éditeur le fait remarquer – ne s’accorde pas toujours bien avec des idées de gauche, mais qui, dans ce cas-ci, convergent effectivement vers des valeurs qui promeuvent une agriculture moins industrielle, monopolisée et homogène. Pour être claire, il est fâché et il n’a pas la langue (ou le stylo) dans sa poche!
Une expérience frustrante
Johanna : Que nous raconte-t-il sur sa propre expérience?
Mariève : Lamontagne commence d’abord au premier chapitre par résumer l’histoire de l’agriculture au Québec, dans ce qu’il appelle une « genèse de la ferme impossible ». Il nous explique entre autres la formation de l’Union des producteurs agricoles (UPA) puis la mise en place des systèmes de quotas.

C’est vraiment au deuxième chapitre que commence le récit plus personnel de sa propre expérience. Avec sa conjointe, il a tenté de mettre sur pied une ferme de laquelle ils pourraient vivre et faire des profits. Ils étaient intéressés à vendre les surplus produits, à faire eux-mêmes boucherie, à transformer les aliments, etc. Mais bien vite, en s’informant des démarches à suivre, ils se sont aperçus qu’en fait il leur était plutôt impossible de réaliser ce rêve.
C’est cette désillusion que Lamontagne raconte dans ce second chapitre, celui que j’ai trouvé le plus intéressant. Mais soyez avertis : le ton est amer, profondément marqué par une irrépressible déception que l’auteur n’essaie d’ailleurs pas de cacher.

Des obstacles bien réels
Johanna : Quels sont donc ces obstacles qui les empêchent d’avoir leur ferme idéale?
Mariève : Premièrement, il faut savoir que le lait, les œufs et le poulet sont tous régis par des mécanismes très contraignants au Québec, soit en particulier les quotas qui sont très chers et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles qui obligent les agriculteurs et agricultrices à se plier à des plans de mise en marché.
Commençons avec les quotas. Je vous donne seulement quelques chiffres. Ces derniers s’achètent comme je l’ai dit à très fort prix. Pour une poule pondeuse, le prix du quota s’élevait, en 2013, à 285$, avec un minimum d’achat de 100 poules. On parle donc de 28 500$. En passant, une personne sans quota peut avoir moins de 100 poules, mais alors elle n’a pas le droit de vendre ses œufs sur le marché, seulement à des particuliers, comme ses voisins. Pour une vache, la valeur du quota s’élevait, en 2015, à 25 000$ par animal, avec un minimum de 10 vaches – soit donc un investissement minimum de 250 000$. Finalement, pour le poulet, les quotas sont cette fois calculés par mètre carré et coûte 900$ l’unité (m2), avec un minimum de 10 m2, ce qui donne droit à environ une centaine de poulets.

On le voit bien ici, démarrer une telle entreprise demande d’investir une somme, seulement pour les quotas, de plus de 300 000$, en plus des bâtiments, des redevances à l’UPA, etc. Avec un revenu d’environ 15 000$ par années, on voit mal comment un agriculteur ou une agricultrice pourrait rentabiliser son investissement initial.
En fait, et c’est l’argument de Lamontagne, c’est que ce système favorise le monopole ou du moins les très grandes fermes industrielles, automatisées et standardisées. À titre d’exemple, seulement 108 producteurs détiennent des quotas pour les œufs, produisant à eux seuls plus de 106 millions de douzaines d’œufs par année. C’est près de 1 million de douzaines d’œufs par producteur. On est loin d’une ferme à échelle humaine! On peut imaginer, aussi, et ce n’est pas un détail, que le traitement des animaux s’en ressent nécessairement.

Comment y arriver?
Johanna : Est-ce que l’auteur propose des solutions?
Mariève : Oui, plusieurs, mais pas toujours de façon très détaillée ou solidement présentée. D’abord, il aimerait que le MAPAQ (le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation au Québec) cesse d’entretenir un discours de peur face à la production artisanale. Il s’en prend vivement aux arguments avancés par le MAPAQ que les petits producteurs seraient moins salubres que les grandes industries. Lamontagne argumente au contraire, chiffres à l’appui, que les risques de contamination sont beaucoup plus élevés sur les surfaces qui traitent des milliers d’animaux.
Ensuite, son livre lui-même est un appel – un cri plutôt – à l’action. En décrivant ses propres démarches ainsi que quelques gains ramassés tout au long de son parcours, il incite définitivement les gens à sortir de leur apathie et à prendre la parole, à questionner les procédures et à agir : prendre leur téléphone, appeler au MAPAQ, à l’UPA et exiger des réponses, par tous les moyens disponibles. Ces organisations doivent se remettre au service des agriculteurs et agricultrices artisanales et non plus seulement au service des monopoles.

Finalement, son chapitre 3, intitulé « Au-delà de la ferme impossible », présente une liste de solutions plus concrètes, comme par exemple de réformer la production hors contingent (c.à.d. sans quotas) en revoyant les minimums permis, notamment en s’inspirant d’autres provinces canadiennes. À titre de comparaison, en Colombie-Britannique, un agriculteur ou une agricultrice peut avoir jusqu’à 399 poules pondeuses et 2000 poulets sans quota. On est loin du 99! Et la Loi sur la mise en marché des produits agricoles n’existe pas. Les producteurs et productrices ont donc le droit de transformer et vendre leurs produits sur le marché.
Il donne aussi des contre-exemples européens. Par exemple, les quotas de lait, qui coûtent ici, je le rappelle, 25 000$ par vache, n’ont jamais coûté plus de 1$ en Europe, avant d’être finalement abolis en avril 2015, nous raconte Lamontagne.

Johanna : C’est une énorme différence! En conclusion, est-ce que tu nous recommande la lecture de cet ouvrage?
Mariève : Définitivement oui, surtout parce que cet ouvrage soulève des questions importantes, nécessaires, qu’avait déjà explorées le rapport Pronovost en 2008, mais que les partis politiques semblent avoir évitées jusqu’à maintenant.
Je pense que l’argumentaire du texte pourrait parfois être plus solide, plus convaincant et moins amer, mais somme toute, le débat est si essentiel qu’un tel cri du cœur, qui est quand même bien documenté, ne peut pas être ignoré. L’ouvrage a le grand mérite de vouloir relancer un débat qui est englué depuis des années. L’auteur nous convainc, si besoin était, qu’il est grand temps que des changements majeurs soient effectués, avant que le système agricole ne meure étranglé par lui-même.
Bref, c’est un ouvrage polémique qui soulève des questions essentielles et qui montre bien que le système actuel n’est ni durable, ni au service d’une agriculture à échelle humaine telle que la réclame les agriculteurs et agricultrices, mais aussi la population, de plus en plus avide d’options locales et de circuits-courts.

Dominic Lamontagne, La ferme impossible
Éditions Écosociété, 2015






Beaucoup de personnes au Québec ont grandis sur des fermes parm is de grandes familles. C,est de cette façon qu’on a pu survivre et bien manger. Mes parents avaient 140 acres cultivables d’où mon père avec mes frères., récoltait les produits nécessaires pour nourrir les animaux que nous avions . Vaches, porcs, poules. Mon père tuait et abbatait un porc et un bœuf dans la grange, chaque année. La viande était coupée par un boucher et mise à la gelée. Nous avions une ferme laitière. Le lait était vendu et on fesait du beurre et jouissait de la crème. Chaque année, les hommes préparait le terrain et on plantait un immense jardin de plus d’un âcre de superficie, qui était remplis de toute sortes de légumes. À l’automne, on rentrait certains dans la cave, sur la terre, et beaucoup allaient en conserves. D’autres étaient gelés. C’était l’autosuffisance complète. On avait la paix. Mon père aussi louait des acres à la Green Giant et prenait un bon revenu à l’automne.
Merci pour cette histoire! 140 acres à cultiver, ça devait être un travail incroyable! Même un acre de potager, c’est beaucoup! Je crois que nous avons tout avantage à ne pas oublier ces méthodes et façons de faire…
Bravo pour ce billet sur le désenchantement de monsieur Lamontagne. Juste par souci de précision et de mise à jour, les règles du jeu du Mapaq (Ministère de l’agriculture, blabla) viennent d’être supposément assouplies. Je suis un petit producteur d’oeufs et je ne peut que rager devant mes nouveaux droits de vendre mes surplus dans un rayon de 150 km de ma résidence, avec quelques grands SAUFS. Ce droit est rendu “nul et non-avenant” par la série d’autres règles 1. de mise en marché à la fois tordue et incohérente, 2. l’étiquetage abusif, 3. la fenêtre écourtée d’écoulement des stocks et quelques autres nouvelles règles contraignantes de la sorte, voire, “impossibilisantes”.
Bonjour Jean-Claude, merci beaucoup pour ces spécifications. Je suis vraiment toujours désolée de lire à quel point ces règlements sont frustrants et contraignants. Je vais me garder à jour le plus possible et continuer de diffuser le mot! Bon courage!
[…] copie écrite de chacune de mes chroniques. J’en ai récemment adapté une pour le blogue : « Avoir une ferme autosuffisante au Québec : un rêve impossible? » À ma grande surprise, cet article est vite devenu un des plus populaires sur mon site. Comme […]
J’ai découvert ce blog par hasard et je le trouve très bien.
Les articles rejoignent ma philosophie “gastronocratique ” et celle du Parti culinaire du Québec.
Thémis
Merci beaucoup pour le commentaire! « Gastronocratique » ; je n’avais jamais vu le mot passer. Je vais aller lire là-dessus. Et je vous invite à suivre ma page Facebook pour être au courant des derniers articles : http://www.facebook.com/histoiredesinspirer.