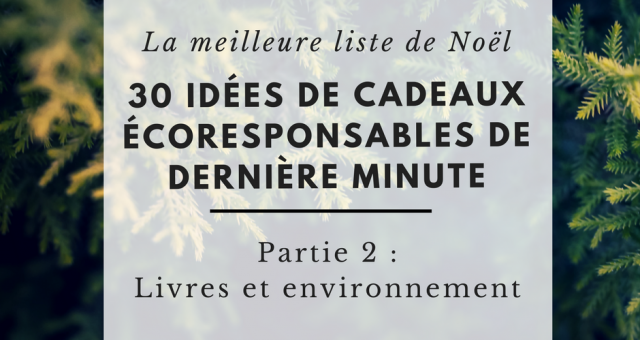Hier soir, 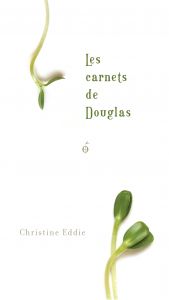 avant de dormir, j’ai attrapé un livre que j’avais depuis quelque temps déjà, un peu oublié, je l’avoue, sur une tablette. C’était Les carnets de Douglas de Christine Eddie (Alto, 2008). J’ai commencé ma lecture en me disant que j’allais lire 15 minutes. Je l’ai reposé plus tard dans la nuit, après avoir tourné la dernière page. Ça ne m’était pas arrivé depuis longtemps.
avant de dormir, j’ai attrapé un livre que j’avais depuis quelque temps déjà, un peu oublié, je l’avoue, sur une tablette. C’était Les carnets de Douglas de Christine Eddie (Alto, 2008). J’ai commencé ma lecture en me disant que j’allais lire 15 minutes. Je l’ai reposé plus tard dans la nuit, après avoir tourné la dernière page. Ça ne m’était pas arrivé depuis longtemps.
Le livre raconte l’histoire de deux jeunes gens qui s’en vont vivre un amour idyllique dans une cabane de bois rond. Comme nous le raconte le 4e de couverture, ils s’installent près d’un « village beaucoup trop discret pour figurer sur une carte. Au cœur de la nature généreuse et sauvage, ils s’aiment, à l’abri des rugissements du vingtième siècle. » Mais – il fallait s’y attendre – un drame surgit et tout bascule. Je ne vous en dis pas plus sur l’histoire, question de ne rien gâcher.
À mesure que la vie des personnages suit son cours, le village et sa forêt changent eux aussi, sous fond de Révolution tranquille très discret. Le béton et les centres d’achat envahissent les lieux, détruisant le charme de l’endroit. Le petit village et la nature qui l’entoure se transforment petit à petit en une ville industrielle et nauséabonde. On ne sait plus trop, pour un moment, ce qui gagne : la beauté ou la laideur. Un thème qui en agacent certains, mais qui pour moi reste le plus important de tous, le seul peut-être qui m’intéresse vraiment.
Dans ce roman, on voit le monde changer à un tournant de l’histoire particulièrement ravageant. Avec sa cabane dans le bois, ce roman se situe un peu hors de l’histoire avec un grand « H »; difficile de ne pas penser aux réflexions de Louis Hamelin et d’Isabelle Daunais sur l’idylle. Quand même, inévitablement, l’histoire rattrape les personnages. C’est le cas notamment de l’institutrice du village, Gabrielle Schmulewitz, une juive rescapée des camps de concentration, à travers qui sont évoqués sans beaucoup les nommer les horreurs de la Guerre.
Mais c’est peut-être surtout à travers la destruction de la nature qui s’opère lentement mais sûrement, justement, que l’histoire rattrape les personnages. Même ce petit village qui ne pouvait se retrouver sur une carte finit par être pollué, enlaidi, rasé, bétonné. Le boisé idyllique ne survit pas. Dans le « Générique » qui clôt l’ouvrage, on apprend que Rose, l’enfant née dans les bois, « vénère les arbres au point de monter aux barricades chaque fois qu’un boisé est menacé » (p. 199). Avec un père rebaptisé du nom du plus grand de tous les arbres canadiens (Douglas) – car les arbres constituent son domaine privilégié (p. 53) – et une mère associée au mélèze, cela ne surprend pas.
Rechercher la beauté, qu’elle soit dans la nature ou la musique (tiens, ça me rappelle les « poètes de la nature » de Saint-Denys Garneau), protéger cette beauté, cela est central dans ce roman. À ce sujet, je vous copie ici l’incipit :
On s’essouffle à parcourir la terre, à l’affût de quelque trésor qui console. On écoute le cha
nt de la mer. On lit un poème. On respire du jasmin. On tombe avec la neige. On cherche un éblouissement qui retentira encore quand les heures creuses reviendront rythmer l’ordinaire, un éclat fulguran
t qu’aucune misère humaine ne peut écraser.Je voulais t’offrir la beauté du monde, un recueil de consolations qui te guiderait douceme
nt vers la lumière. C’est tout ce que j’ai trouvé pour ne jamais te quitter. Il m’aura fallu beaucoup trop de temps pour comprendre qu’ici ou ailleurs, loin de toi, la lumière est toujours tamisée. Il y a des silences impardonnables et j’essaie de me rassurer en songeant que je t’aurai au moins épargné le spectacle de ma détresse. Mais je n’écrirai plus, c’est mon dernier carnet, je te le promets. Je reviens. Attends-moi.
Gabrielle Roy écrivait quelque part que rien ne la consolait davantage que le spectacle de la nature. Dans Les carnets de Douglas, on le constate dès l’incipit : ce n’est pas seulement la nature qui console, mais elle fait partie de ces beautés qui réconcilient avec la vie lorsque vivre fait mal.
La nature dans Les carnets disparaît tranquillement; cela fait aussi parti du drame. Le personnage va la rechercher, toujours plus loin, à travers le monde. Mais il ne faut pas pour autant conclure qu’il s’agit d’une simple célébration de la nature. D’ailleurs, le roman se termine en ville. Plus largement, il s’agit d’une réflexion sur la « beauté fragile du monde », dont la nature ne peut être dissociée.
Parlant de beauté, l’écriture de Christine Eddie est comme la musique de la clarinette dont joue Douglas, le personnage principal : elle va droit au cœur. Je caricature un peu, mais son style me fait penser à ceux de Borgues et Garcia Marquez à la fois – une touche de merveilleux ici et là – et même un peu à celui de Boris Vian, dans son ambivalence entre la légèreté et le drame. Un de ces livres qui me rappellent pourquoi j’aime la littérature.