J’ai eu l’idée d’une nouvelle section qui décrirait un peu la vie au doctorat et les défis auxquels font face les doctorant.es. Le but est triple; premièrement, démystifier un peu cette occupation; deuxièmement, offrir quelques outils pratiques pour écrire de façon plus productive; troisièmement, ET SURTOUT, partager avec vous cette aventure dans le but utilitariste d’avoir des comptes à rendre.
C’est pourquoi dans cette deuxième chronique j’ai choisi de vous parler un peu de mon parcours académique, question de me présenter et de commencer à vous décrire un peu à quoi peut ressembler ma vie de doctorante, vu que ça semble bien mystérieux pour plusieurs personnes!
Avant les cycles supérieurs

Devant mon cégep, à Victoriaville, où j’ai fait mes sciences de la nature, il y a longtemps déjà!
J’ai un parcours assez atypique, qui a été tout sauf une ligne droite. Après un cégep en sciences de la nature, je me suis sauvée en Europe pendant quelques mois pour réfléchir à mon avenir. En effet, mon cégep n’avait pas été facile. Alors que j’étais une excellente étudiante au secondaire, je me suis mise à échouer des cours (math et physique) et à passer les autres cours de sciences avec des 60% (chimie et même biologie). C’est clair : je ne savais pas étudier.
Merci à mon professeur de physique, Ricardo Dorcal, qui m’a donné mes premiers outils pour étudier. Il m’a appris bien plus que de la physique. Avec patience, il m’a démontré que le travail et le temps qu’on est prêt à investir dans un but, bref notre engagement, était le facteur #1 de la réussite, plutôt que nos aptitudes naturelles. Je n’ai jamais oublié cette leçon même si je l’ai parfois perdue de vue pendant certaines périodes de ma vie.

À la conquête du monde et des montagnes, à 19 ans! Photo de gauche : dans les Alpes, à Chamonix. Photo de droite : à Paris.
À mon retour de voyage en sac-à-dos, je me suis inscrite à l’université en littérature française à l’Université McGill. J’avais décidé d’abandonner les sciences qui, je croyais, n’étaient pas pour moi, même si l’écologie me fascinait. Après trois ans à étudier les livres, j’ai eu envie de retourner jouer dehors. Je suis partie en Colombie-Britannique travailler sur une ferme maraîchère et j’y suis restée deux ans.
Je suis ensuite revenue à Montréal. Je n’avais pas abandonné mon envie d’étudier l’écologie. J’ai fait un diplôme de premier cycle en sciences environnementales et agriculture, toujours à McGill. J’ai eu la piqûre. Malheureusement, aucun programme de cycles supérieurs (maîtrise et doctorat) en environnement ne faisait de place alors aux humanités environnementales (arts, communication, littérature, philosophie, etc.) dans les universités québécoises. Aussi, comme j’étais surtout intéressée par l’histoire de l’idée de nature et les discours environnementaux au Québec, je me suis réinscrite en littérature, avec la ferme intention de combiner les deux domaines. Je ne savais pas dans quoi je m’embarquais!
La maîtrise
Une chose que j’ai apprise en cours de route, c’est que beaucoup de départements universitaires n’encouragent pas l’interdisciplinarité, malgré la nécessité de penser au-delà des frontières disciplinaires, surtout pour des situations aussi complexes que la crise environnementale. Il y a sans doute une peur, en partie justifiée je dois dire, de l’éparpillement, une peur de la généralisation sans profondeur. Pourtant, après deux programmes de premier cycle, je me sentais prête à ouvrir ce nouveau sentier. Et puis j’ai la tête dure.

J’ai découvert que, bien sûr, je n’étais pas la première à vouloir marier littérature et environnement. Aux États-Unis et au Canada anglais, de nombreux programmes offraient déjà cette option. Ce champ d’études se nomme « écocritique » ou « critique environnementale ». Au Québec en revanche, rien du genre n’existait au début des années 2000. Je crois que cela a grandement contribué à me motiver et à persévérer dans ce champ. La simple d’idée d’être la « première » à travailler sur un sujet (on n’est jamais vraiment la première, je l’ai compris plus tard) est, pour une étudiante à la maîtrise, une véritable chance. C’est un peu comme un raccourci vers la reconnaissance d’être un expert dans son domaine, puisque personne d’autres n’en sait plus que soi sur le sujet (enfin, on peut le penser pendant quelques années!).
Aussi, j’ai compris qu’il y avait différentes sortes d’étudiants (et c’est bien correct ainsi) : celles et ceux qui ont envie de participer à un projet de recherche en cours (celui de leur directeur ou directrice de thèse ou alors d’un groupe de recherche) et les autres qui ont une idée bien précise de ce qu’ils ou elles veulent faire comme recherche. Je faisais partie de cette deuxième catégorie.
La maîtrise consiste généralement en une année de cours, des séminaires en petits groupes, suivie d’une année de rédaction. On choisit un sujet sur lequel travailler, on le peaufine un peu dans les séminaires la première année, puis on rédige pendant environ un an. Mes recherches portaient sur les représentations de la nature dans la littérature québécoise, de 1840 à 1940.
La rédaction a été difficile, surtout compte tenu du fait que, malgré les meilleures bourses d’études (CRSH et FQRSC), je travaillais beaucoup en tant qu’assistante de recherche puis auxiliaire d’enseignement à l’École de l’environnement de McGill. Aussi, je manquais de discipline pour écrire régulièrement…
Commencer à enseigner
Pour la plupart des étudiant.es aux cycles supérieurs, la première expérience pratique d’enseignement est d’être auxiliaire. Cette personne est là pour assister le professeur. Le plus souvent, son rôle consiste à corriger les examens et travaux et parfois à s’occuper d’animer des discussions ou des séances de tutorat.
Après quelques sessions, j’ai été « promue » chargée de cours, à la toute fin de ma maîtrise. Le chargé de cours est comme un professeur, mais contractuel. Il donne le cours et la plupart du temps le met aussi sur pied. Un chargé de cours n’a généralement pas d’auxiliaire d’enseignement; il ou elle doit donc s’occuper aussi de corriger les travaux.
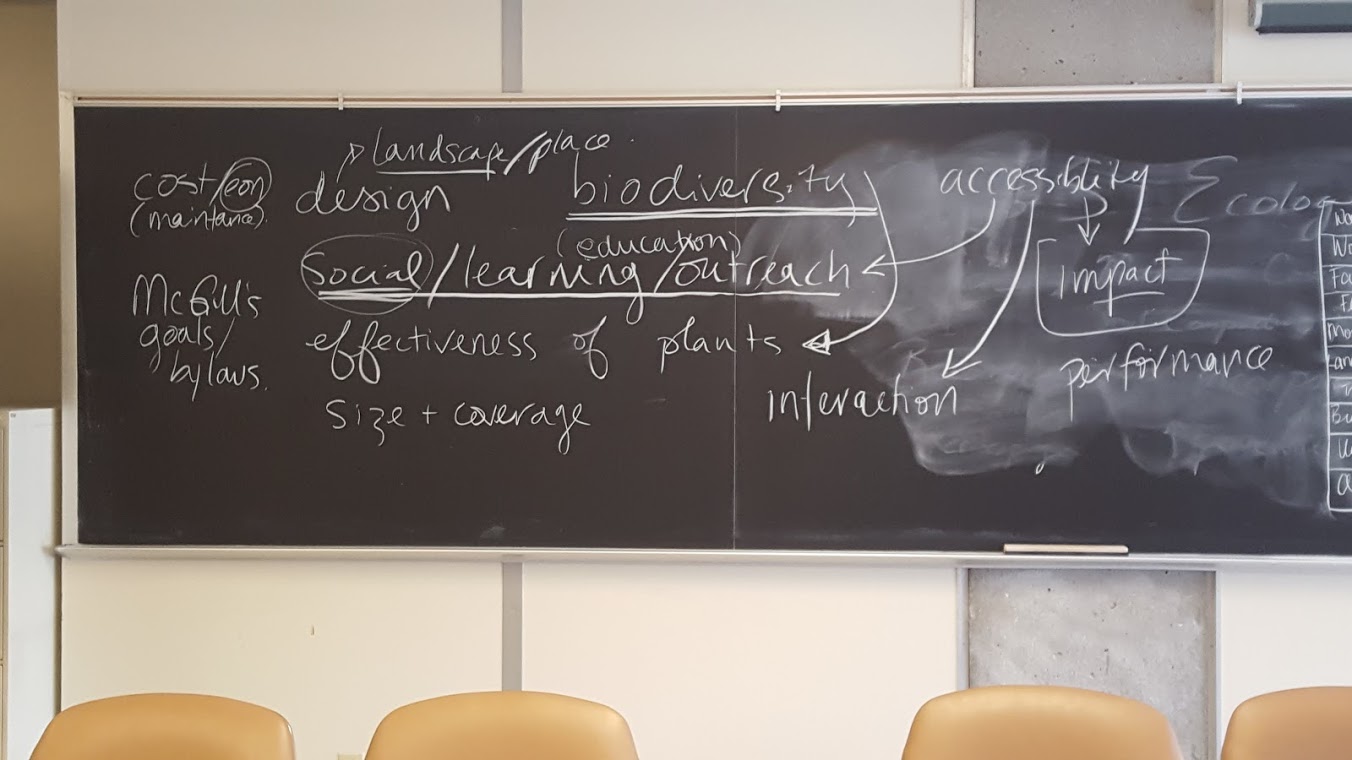
Je ne sais plus ce que j’enseignais cette journée-là, mais…
Le cours que j’ai commencé à enseigner s’appelait « Environmental thought » (« La pensée environnementale »). C’était parfait pour explorer mon sujet de mémoire et, plus tard, de thèse. J’étais terrifiée au début et j’avoue que cette frayeur ne m’a quittée qu’après une dizaine d’années (enfin)! Tout de même, j’ai beaucoup apprécié cette première chance. Non seulement l’École d’environnement m’offrait des charges de cours, mais j’avais tout son support dans mon aventure interdisciplinaire. J’ai donc décidé de poursuivre au doctorat.
Pourquoi le doctorat
Encore ici, il existe toutes sortes de motivations pour entreprendre un doctorat. Certaines sont excellentes, d’autres moins. Je n’irai pas jusqu’à dire que je l’ai commencé pour les mauvaises raisons, mais certainement je reconnais maintenant qu’il me manquait peut-être un ingrédient ou deux pour être vraiment productive à la rédaction. Je m’explique.
Les professeurs nous le répètent souvent : le doctorat sert principalement à enseigner à l’université. Or, seule une minorité arrive à se trouver un poste. Souvent, cette décision vient avec un coût élevé, qu’il s’agisse de s’exiler dans une université lointaine, de passer au travers d’un (ou plusieurs) post-doctorats (principalement de la recherche payée) ou encore du long chemin tumultueux qui mène à la permanence, si par chance on obtient un poste.
Pour moi, enseigner à l’université n’a jamais été le but ultime. Tout d’abord, je ne suis pas intéressée à aller enseigner au bout du monde ni à faire des compromis sans fin. Ensuite, je suis anxieuse. Enfin, je l’étais énormément; je le suis beaucoup moins maintenant. Une histoire pour un autre jour. Bref, enseigner n’a pas été ce qui a motivé mon entrée au doctorat.
Je crois qu’il y a eu simultanément deux raisons principales expliquant ma décision. Premièrement, je n’avais pas, durant la maîtrise, trouvé toutes les réponses à mes questions. J’avais dû m’arrêter en 1940 (plus ou moins) dans l’étude du corpus québécois. 100 ans de littérature pour un mémoire de maîtrise, c’était déjà vertigineux. J’avais envie de continuer à explorer mon sujet, surtout que j’ai toujours été convaincue non seulement de son importance mais aussi de l’inévitable intérêt qu’il allait bientôt susciter (je n’avais pas tort). Sentir que l’on est au bon endroit, au bon moment est extrêmement motivant!

Avec la merveilleuse équipe de Montreal’s Urban Sustainability Experience (MUSE) et M. McGill. De gauche à droite : Julia Freeman, Sylvie de Blois, (M. McGill), moi-même et Kevin Manaugh. Il manque Elena Bennett qui fait aussi partie du programme, mais qui était en sabbatique cette année-là.
Deuxièmement, j’avais un emploi à temps partiel bien rémunéré à l’École de l’environnement de McGill. On me faisait entrevoir de belles possibilités de charges de cours pour le doctorat, dans mon domaine, une occasion qui était à peu près impensable ailleurs. Et effectivement, j’ai eu, au cours de mon doctorat, de merveilleuses expériences d’enseignement, notamment avec le programme d’été (et de terrain) Montreal’s Urban Sustainability Experience et de subséquentes collaborations, notamment avec le McGill Writing Centre – le Centre de communication écrite, pour lequel je travaille encore à ce jour.
Qui plus est, je m’attendais à recevoir d’autres importantes bourses d’études et encore une fois je ne m’étais pas trompée. Les deux combinées (les charges de cours et les bourses), je gagnais un « salaire » plus qu’honorable tout en continuant de faire quelque chose que j’avais toujours adoré : étudier. Pourquoi, me suis-je alors demandé, irais-je tout de suite sur le marché du travail? J’ai donc ainsi commencé ma « carrière étudiante ».
Réflexions
Voilà donc comment je me suis rendue à faire un doctorat. Par passion, par curiosité et aussi parce que j’aimais mon université et que je n’avais pas envie de la quitter. Ce n’est pas que j’avais peur du marché du travail. En fait, j’y étais déjà depuis plusieurs années, à temps partiel, certes, mais accumulant depuis quelques années une expérience enrichissante.
C’est donc plus par passion que par peur que je suis restée dans le milieu académique. Enfin j’aime le penser. Sûrement qu’il y avait aussi de la peur de l’inconnu là-dedans et pas juste un petit peu! J’avais peur du 9 à 5, de la routine métro-boulot-dodo, de l’enracinement dans un mode de vie qui, je le crois encore, ne me convient pas. D’être prise pour toujours dans la ville. C’est tout un luxe, je le sais bien, de ne pas vouloir faire du 9 à 5, mais le fait est que c’est possible – en tout cas ce l’était pour moi à ce moment-là et ce l’est encore.
Est-ce que je regrette cette décision? Pas du tout. Cette année, une grosse mise au point s’est imposée. Mais ces années auront été remplies de défis, certains plus agréables que d’autres, d’apprentissage, de liberté aussi.

Les bibliothèques McLennan et Redpath où se trouve le Centre de communication écrite.
Après, ma vie a pris un tournant inattendu, avec une séparation déchirante qui a fait dérailler ma vie pendant quelques années. Heureusement j’ai pu compter sur ma famille et mes amis pour m’épauler. Et maintenant je vais mieux que jamais! Ma thèse est presque terminée et je vois enfin de la lumière au bout de ce tunnel-là.
Pour m’aider à passer au travers de ces derniers mois, j’ai décidé de vous prendre à témoin en vous tenant au courant de mes progrès. À partir d’aujourd’hui, je vais vous rendre des comptes sur mon écriture.
À bientôt,
Mariève
xx





